8ème session de formation à l'EPU
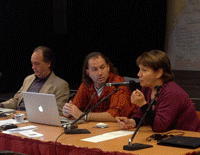 Le CIFEDHOP organise à Genève, du 16 au 22 octobre 2013, la 8ème Session internationale de formation à l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme pour les acteurs de l’éducation et de la société civile. Cette formation est prioritairement destinée aux enseignants/éducateurs/chercheurs et ONG actifs dans le domaine de l’éducation aux droits humains.
Le CIFEDHOP organise à Genève, du 16 au 22 octobre 2013, la 8ème Session internationale de formation à l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme pour les acteurs de l’éducation et de la société civile. Cette formation est prioritairement destinée aux enseignants/éducateurs/chercheurs et ONG actifs dans le domaine de l’éducation aux droits humains.
Cette Session est organisée avec le soutien financier du Département fédéral des affaires étrangères, de la République et Canton de Genève et de la Ville de Genève.
Documentation remise aux participants 8e
1. Résolution de l’AG des Nations Unies créant le Conseil des droits de l’homme (A/RES 60/251)
3. Nouvelles modalités EPU, second cycle, UPR-Info.org
4. Fiche d’information : Examen Périodique Universel, UPR-Info.org
5. Calendrier du second cycle de l’EPU (2012 – 2016)
6. Programme de la 17ème Session de l’EPU
11. Guide : faire progresser les droits de l’enfant, Save the Children
12. Guide : plaidoyer pour EPU, Save the Children
13. 100 et1 mots pour l’éducation aux droits de l’homme, EIP, 2013
14. Education aux droits de l’homme : questions et réponses, Cifedhop, 2011
Déroulement de la 8e session
Cette rubrique permet d'accéder au contenu de la 8e session de formation à l'EPU du Conseil des droits de l’homme pour les acteurs de l’éducation et de la société civile : enregistrements audio des interventions et des discussions, présentations Powerpoint et rapports d'ateliers.
Cliquer sur chacune des journées pour accéder à la documentation et aux enregistrements
Programme
Mercredi 16 octobre 2013
Pré-session pour les personnes ayant peu de connaissances sur l’EPU (en sections linguistiques)
| 11h00-13h00
|
Introduction au Conseil des droits de l’homme et à l’Examen périodique universel (EPU) |
| 14h00-16h30 | - Les procédures de l’EPU : Yves Lador |
Jeudi 17 octobre 2013
Séance d'ouverture
Vendredi 18 octobre 2013
L’EPU, un bilan national des doits de l’homme
| 9h00-10h15 |
Typologies des bilans en matière de droits fondamentaux |
| 10h45-12h30 | L’égalité de droits homme-femme - Mme Paola Daher, Cairo-Institute - Mme Pooja Patel, Forum-Asia |
| 14h00-15h00 | Le droit à l’eau et à l’assainissement - M. Jean-Benoît Charrin, WaterLex |
| 15h00-16h00 | Les droits des populations vulnérables - M. Mikeal Repelin, Franciscain International |
| 16h30-18h00 | Groupes de travail sur les priorités pour l’EPU |
Samedi 19 octobre 2013
L’EPU et l’éducation aux droits de l’homme
Lundi 21 octobre 2013
| 9h00-17h00 | Observation de la 17ème Session de l’EPU au Palais des Nations |
| 17h30 | Réception, Centre d’accueil, Genève internationale (CAGI), La Pastorale, 106, route de Ferney |
Mardi 22 octobre 2013
| 9h00-17h00 | Observation de la 17ème Session de l’EPU au Palais des Nations |
| 19h00 | Réception d’au-revoir, Hôtel Ibis |
Interventions jour 1 (8e)
Jeudi 17 octobre 2013
Cliquer sur les liens pour écouter les interventions en français (fr), en espagnol (es) ou en anglais (en) et télécharger les fichiers
Allocutions de bienvenue
M. Guy-Olivier Segond Président du CIFEDHOP (fr) ![]()
M. André Klopmann, Secrétaire adjoint chargé des affaires générales et internationales, Chancellerie d’Etat, Genève(fr) ![]()
- M. Gérard Perroulaz, Délégation Genève Ville solidaire (fr) ![]()
- Mme Monique Prindezis, Directrice du CIFEDHOP (fr) ![]()
Sensibiliser et former à l’EPU, le rôle de la société civile
Les spécificités du 2e cycle d’examens périodiques universels : M. Roland Chauville, UPR-Info (fr) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr) ![]() Partie 4 (questions) - Partie 5 (réponses) - Partie 6 (questions réponses) - Partie 7 (questions) - Partie 8 (réponses)
Partie 4 (questions) - Partie 5 (réponses) - Partie 6 (questions réponses) - Partie 7 (questions) - Partie 8 (réponses)
Mobiliser la société civile : M. Philippe Dam, Human Rights Watch (en) ![]() Partie 1 -
Partie 1 - ![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échange avec les participants (fr, en) ![]()
Partie 3 (échanges) - Partie 4 (questions réponses) - Partie 5 (questions) - Partie 6 (réponses) - Partie 7 (questions réponses) - Partie 8 (questions réponses)
Expériences de coalitions nationales
Mexique - Mme Gloria Ramirez, Chaire Unesco des droits de l’homme, Université, Mexico (es) ![]() Partie 1- Partie 2 - Partie 3 - Partie 4
Partie 1- Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 ![]() Présentation Powerpoint (es)
Présentation Powerpoint (es)![]() Lire le résumé
Lire le résumé
États Unis - M. Joshua Cooper (en) ![]() Partie 1- Partie 2 - Partie 3 - Partie 4
Partie 1- Partie 2 - Partie 3 - Partie 4![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr, en, es) ![]()
Partie 1 (questions) - Partie 2 (réponses Gloria Ramirez) - Partie 3 (réponses Joshua Cooper) - Partie 4 (questions) - Partie 5 (réponses)
Interventions jour 2 (8e)
Vendredi 18 octobre 2013
L’EPU, un bilan national des doits de l’homme
Cliquer sur les liens pour écouter les interventions en français (fr) ou en anglais (en) et télécharger les fichiers
Typologies des bilans en matière de droits fondamentaux
- M. Yves Lador (fr) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 - Partie 8 - Partie 9 - Partie 10
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 - Partie 8 - Partie 9 - Partie 10![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges vec les participants (fr, en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
L’égalité de droits homme-femme
Présentation de Mme Paola Daher Par Yves Lador (en) ![]()
- Mme Paola Daher, Cairo-Institute (en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr, en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5
Présentation de Mme Pooja Patel, par Yves Lador (en) ![]()
- Mme Pooja Patel, Forum-Asia (en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr, en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Le droit à l’eau et à l’assainissement
Présentation de M. Jean-Benoît Charrin par Yves Lador (en) ![]()
- M. Jean-Benoît Charrin, WaterLex (en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr, en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 - Partie 8 (questions) - Partie 9 (réponses) - Partie 10 (conclusion)
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 - Partie 8 (questions) - Partie 9 (réponses) - Partie 10 (conclusion)
Les droits des populations vulnérables
Présentation de M. Mikeal Repelin par Yves Lador (fr) ![]()
- M. Mikeal Repelin, Franciscain International (fr) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Échanges avec les participants (fr, en) ![]() Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6
Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6
Groupes de travails sur les priorités pour l’EPU (fr)![]() Présentation Yves Lador
Présentation Yves Lador![]() Lire le résumé
Lire le résumé
Rapport des groupes de travail Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7
Interventions jour 3 (8e)
Samedi 19 octobre 2013
L’EPU et l’éducation aux droits de l’homme
Cliquer sur les liens pour écouter les interventions en français (fr) ou en anglais (en) et télécharger les fichiers
Travailler avec la presse et les réseaux sociaux
Mme Jane Larsen, International Media Support (IMS), Danemark,(en) Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 Présentation Powerpoint (en) ![]() Lire le résumé
Lire le résumé ![]()
Échanges avec les participants (fr, en) - Partie 8 - Partie 9 - Partie 10 - Partie 11 - Partie 12 - Partie 13 - Partie 14 -![]()
L’EPU, un instrument d’éducation aux droits de l’homme
- M. Yves Lador (en) Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 - Partie 5 - Partie 6 - Partie 7 - Partie 8 - Partie 9 - Partie 10 - Partie 11 ![]() Lire le résumé
Lire le résumé![]()
Échanges avec les participants (fr, en) Partie 1 - Partie 2 (réponses) - ![]()
Intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans l’EPU
- M. Joshua Cooper (en) Partie 1 - Partie 2 - ![]() Lire le résumé
Lire le résumé![]()
La Déclaration des Nations Unies sur la formation et l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme
Présentation de Ramdane Babadji par Monique Prindezis ![]()
- M. Ramdane Babadji, Maître de conférence, Université Paris VII (fr) Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 ![]() Lire le résumé
Lire le résumé ![]()
- Mme Monique Prindezis (fr) Partie 1 ![]()
Échanges avec les participants (fr, en) Partie 1 - Partie 2 (réponse) - Partie 3
Présentation de l'EIP et du CIFEDHOP Monique Prindezis
Conclusions Joshua Cooper (en) ![]()
Résumé des interventions 8e session
Les spécificités du 2e cycle d’examens périodiques universels Mr Chauville
M. Roland Chauville, UPR-Info (http://www.upr-info.org/-fr-.html). UPR Info est une organisation non gouvernementale (ONG) basée à Genève, Suisse, qui a pour buts de médiatiser l’Examen Périodique Universel (EPU) et de favoriser la bonne participation des différents acteurs du mécanisme, à savoir les États membres des Nations Unies, les ONG, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile dans son ensemble. Le premier succès de l’EPU a consisté à placer les droits de l’homme au centre des discussions au sein des Nations Unies bien que la sécurité et le développement occupent une plus large place. S’agissant du 1er cycle de l’EPU (2008-2012), la première avancée fut d’obliger également les États à discuter entre eux de la situation des droits de l’homme (selon le conférencier, 70% des recommandations formulées au sein du Conseil des droits de l’homme auraient été acceptées par les États), d’inciter les gouvernements à prendre en compte les besoins de la société civile et d’associer les ambassades au processus de collecte de données. Le 2e cycle (depuis 2013) est l’occasion d’apprécier la suite donnée par les États aux recommandations qui furent portées à leur attention lors du cycle précédent. Par ailleurs, un faible pourcentage de celles-ci demeurent en lien avec les prestations des États durant le 2e cycle. C’est donc dire que le risque est bien présent de voir se transformer le discours des États en catalogue de bonnes intentions sans suites. Enfin, fait à noter : le retrait de l’État d’Israël du Conseil des droits de l’homme et, par conséquent, la non participation à ce jour de cet État à son propre examen prévu le 29 janvier 2013. Cette attitude de retrait laisse planer la crainte, par effet d’entraînement, de voir d’autres États emboîter le pas d’autant plus que le Conseil ne dispose toujours pas de mesures de contrainte appropriées devant un tel cas de figure.
Les spécificités du 2e cycle d’examens périodiques universels Mr Dam
M. Philippe Dam, Human Rights Watch (http://www.hrw.org/fr). Lorsqu’il est question de la participation de la société civile au processus de l’EPU, il convient de demeurer réaliste : évaluer ce qui de l’ordre du possible et ce qui ne l’est pas. L’EPU est un dispositif d’ordre diplomatique sous le contrôle des États, non pas un dispositif onusien contraignant. L’ensemble des revendications de la société civile ne trouve pas écho au sein de ce processus et les résultats de cette dynamique peuvent être assez décevants. L’intérêt de ce dispositif, en revanche, est qu’il permet de mettre en lumière les obligations d’un État face aux droits de l’homme. En fait, pour les ONG, l’EPU devrait être perçu comme un outil leur permettant une meilleure visibilité auprès des États, notamment en matière des suites à donner aux recommandations qu’elles ont formulées. Les ONG peuvent également miser sur la nature publique du processus de l’EPU, ce qui permet aux sociétés civiles nationales d’être tenues informées de son évolution et des ses enjeux et, si possible, d’interpeler les pouvoirs. Ainsi, au cours du 2e cycle, une des cibles privilégiées devrait être les gouvernements eux-mêmes de manière à les inciter à consulter les ONG en toute transparence, à faire en sorte que les délégations gouvernementales soient de nature pluridisciplinaire et qu’elles s’engagement à prendre en compte les observations de la société civile organisée ainsi que les résultats attendus en matière de mise en œuvre des recommandations. À cet égard, le monde des médias (nationaux et internationaux) peut se révéler très utile en tant que passeur de relais.
Le droit à l’eau et à l’assainissement : Jean-Benoît Charrin,
M .Jean-Benoît Charrin, représentant de Waterlex (http://www.waterlex.org/); fondée à Genève en 2010, cette organisation œuvre à définir le cadre de bonne gouvernance de l'eau du futur. L’économie générale de l’exposé fut consacrée à l’« application » du droit à l’eau et à l’assainissement dans la perspective de formation de praticiens du développement. Dès lors la question se pose quant à savoir comment avoir le plus « d’« impact » sur le terrain? Et une boîte a outils (http://www.waterlex.org/waterlex-toolkit/project-cycle-management/situation-analysis/) permet la saisie d’ensemble des interventions possibles par cycle, à commencer par l’analyse de la situation pour ensuite passer aux phases successives de planification, de budgétisation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Cette approche a le mérite de s’appliquer à la fois aux projets d’infrastructure et à la nouvelle gouvernance de l’eau, ce qui implique la maîtrise d’une dynamique complexe au sein de laquelle interviennent de nombreux acteurs. Une banque de données (en anglais) permet d’illustrer le propos (http://www.waterlex.org/waterlex-legal-database/).
L’EPU, un instrument d’éducation aux droits de l’homme (EDH) :Yves Lador
Yves Lador. Les liens entre l’EPU et l’EDH sont en quelque sorte le parent pauvre de cet examen. Pourtant, l’EPU offre une voie d’accès à l’EDH qui mériterait d’être empruntée. En raison de son caractère public – les séances du Conseil des droits de l’homme – rien n’empêche, en principe, un éducateur d’utiliser en toute légitimité l’information qui en découle lors d’un cours [du moins, on imagine, dans les pays où la liberté d’expression est respectée]. En outre, l’EPU est une source d’information (notamment la compilation des références onusiennes, qui contiennent tout ce qui a pu être dit sur tel ou tel État - par ex. : liste des ratifications -, les rapports de ONG et la documentation accessible depuis le site Internet du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (http://www.ohchr.org/). Par ailleurs, les enseignants manquent de formation pour une telle éducation, notamment au plan juridique. L’EDH doit aussi se caractériser par sa fonction critique en liant, par exemple, un contexte donné à des questions relatives au droit dans son acception la plus large [La fonction critique de l’enseignement – et de la pédagogie – a été et continue d’être aujourd’hui largement débattue. Plusieurs expressions de cette pensée participent de ce paradigme. - NDLR]. Qui plus est, il apparaît difficile d’éduquer aux droits de l’homme en milieu scolaire si cette éducation est coupé de la réalité dans laquelle nous nous trouvons [postures enseignantes hors contexte, « école sanctuaire », inféodation idéologique – NDLR].
Expériences des coalitions nationales 8e session
Mme Gloria Ramirez, Chaire Unesco des droits de l’homme, Université autonome de Mexico. (http://catedradh.unesco.unam.mx/). Mme Gloria Ramirez a présenté les activités de la société civile sur l’EPU depuis 2009. Le deuxième rapport du Mexique sera présenté en octobre 2013. 43 communications d’ONG, de coalitions et d’institutions académiques ont été envoyées au Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Mme Ramirez a rappelé le contexte extrêmement violent du Mexique qui touche plus particulièrement les femmes et les jeunes de 12-23 ans. Et de rappeler qu’environ 95% des homicides des femmes restent à ce jour impunis. Malgré l’aggravation des violations des droits de l’homme, la société civile mexicaine est très active au plan national (manifestations, dénonciations, activités d’éducation aux droits de l’homme) et participe pleinement aux organes des traités onusiens (notamment le Comité contre la discrimination à l’égard des femmes et le Comité contre la torture).
M. Joshua Cooper, Hawai’s Institute for Human Rights/Institut hawaïen des droits de l’homme (http://www.human-rights-hawaii.org/). L’intervenant parle, en tant qu’activiste et coordonnateur des ONG nationales et des consultations conduites aux États-Unis d’Amérique. À cet égard, ONG, universités et membres de la société civile ont travaillé de concert pendant un an et demi. Vu sous cet angle, le processus EPU aurait fait office de déclencheur. Les technologies de l’information et de la communication ont joué un rôle non négligeable au sein de cette dynamique interactive. Les enjeux sont multiples (Guerre en Afghanistan, peine de mort, non ratification d’instruments internationaux, …) et les ONG nombreuses d’où le défi d’unifier l’action et de cibler des enjeux jugés majeurs. Sur place, à Genève, aux Nations Unies, il importait d’avoir l’appui d’États acceptant d’interroger le représentant des États-Unis sur différents aspects des droits de l’homme dans ce pays. Par ailleurs, le recours aux médias sociaux paraît désormais comme une élément stratégique incontournable.
Groupes de travail sur la mobilisation de la société civile
M. Joshua Cooper, animateur. Retour sur les prestations de la journée. L’exercice poursuit un double but : apprendre à préparer un cadre d’intervention dans le but de mobiliser la société civile et faire en sorte que les enjeux à soulever dans le cadre de l’EPU soient perçus comme pertinents pas l’ensemble de la population. Dans ce contexte, il est proposé à l’attention des participants une série de questions : 1) y a-t-il dans votre pays une coalition nationale? 2) Dans l’affirmative, ce regroupement a t-il réussi à produire un rapport au sein duquel les recommandations ont trouvé écho au sein de l’EPU? 3) Quelles sont les difficultés qui ont pu surgir lors de la création d’une coalition nationale? 4) Quels peuvent être les sujets de l’EPU susceptibles d’intéresser la société civile? 5) Est-ce que le processus interne de l’EPU établit des priorités pour votre pays? 6) Quels sont les objectifs à court et à long terme qui peuvent être atteints? 7) Qu’est qui devrait paraître « attrayant » aux yeux du public en général dans votre pays? 8) Qui devrait « paraître » au premier plan (médiatique) pour que cet engagement suscite un intérêt marqué au sein du public?
Groupes de travail sur les priorités pour l’EPU : Yves Lador.
Deux questions opèrent en toile de fond des travaux de groupe des participants : i) « quels seraient les moyens les plus adéquats de réaliser un bilan participatif de l’état des droits fondamentaux dans votre pays? » et ii) « les arguments principaux militant en faveur du choix desdits moyens adéquats? ».
Intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans l’EPU : Joshua Cooper
M. Joshua Cooper. À cet égard, trois questions se posent dans le cadre du 2e cycle de l’EPU : que pouvons-nous faire? Comment tirer profit de l’information disponible? Quelles peuvent être les meilleures recommandations à faire à son gouvernement? Rappelons, nous dit M. Cooper, qu’aucun pays ne possède à ce jour un programme d’intégration de l’EDH ni dans le cursus scolaire, ni au sein de la formation tout au long de la vie. Sur ce point, il est évoqué l’idée faire campagne auprès des États en faveur de cette éducation comme, par exemple, les coalitions LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) ont pu le faire pour défendre leurs intérêts particuliers. Une telle approche permet de repérer les bonnes pratiques dont on peut toujours s’inspirer en prenant en compte cinq conditions : sa spécificité, sa mesurabilité, son accessibilité, sa pertinence et son caractère opportun.
La formation et l’éducation dans le domaine des droits de l’homme : Ramdane Babadji
M. Babadji a abordé la question de l’éducation aux droits de l’homme (EDH) autour de trois questions qui sont, selon lui, indissociables.
Tout d’abord, l’EDH suppose la connaissance de textes de droit. Mais en même temps, ces textes sont nombreux et, parfois très techniques. Pour autant, selon le conférencier, sans négliger cette difficulté, en fonction de l’âge et du niveau des élèves, la vulgarisation et donc la transmission sont possibles. A titre d’exemple il est possible de prendre comme point de départ la DUDH qui contient en germe l’ensemble des droits de l’homme à travers notamment les notions de dignité, de liberté et d’égalité.
L’EDH c’est ensuite une question de contexte, c’est ce que le conférencier a appelé « Les droits de l’homme dans l’éducation ». Le milieu scolaire doit être immergé dans les droits de l’homme : organisation, fonctionnement, participation de l’ensemble des membres de la communauté scolaire, respect des droits des enseignants, des parents, etc.
L’EDH est enfin une question de méthodes. Il ne s’agit pas d’un savoir qui doit être transmis comme le seraient les mathématiques par exemple sans discussion mais d’une éducation aux règles et valeurs qui sous-tendent les droits de l’homme, ce qui suppose un débat critique. De plus, les méthodes utilisées doivent être appropriées c’est-à-dire fondées sur l’adhésion et non sur la contrainte et l’autoritarisme ce qui serait totalement contre-productif.
Les droits des populations vulnérables : Mikeal Repelin
M. Mikeal Repelin, Franciscain International (FI), ONG consacrée à la lutte aux injustices qui frappent les populations vulnérables et défavorisées – femmes, enfants, peuples autochtones, …) (http://franciscansinternational.org/). Cette ONG s’emploie, entre autres, par le biais d’un rapprochement entre Franciscains et membres de la société civile, à associer les populations aux mécanismes de l’ONU - dont l’EPU - pour faire valoir leurs droits face aux spoliations dont elles sont l’objet. Une des approches privilégiées est le plaidoyer. Il s’agit, selon FI, d’un processus qui permet aux personnes de participer aux décisions qui les concernent ou concernent la vie des autres, et de trouver les solutions à long terme à leurs problèmes. Le plaidoyer, ajoute-on, est l’outil utilisé par les ONG et la société civile pour influencer les principaux dirigeants afin de donner la priorité aux besoins des millions de sans voix, marginalisés et exclus dans le monde entier. À Genève, FI travaille avec le Conseil des droits de l’homme.
L’égalité de droits homme-femme : Pooja Patel,
Mme Pooja Patel, Forum-Asia (http://www.forum-asia.org/). Fondé en 1991 à Manille, aux Philippines, Forum-Asia est une organisation régionale de défense et de promotion des droits de l’homme incluant le droit au développement. Eu égard à l’Asie, Il convient de jeter un regard privilégié sur le rôle de la société civile au sein de la dynamique de l’EPU. Celle-ci est d’abord nationale avec un prolongement à Genève pour un court laps de temps. Au terme du 1er cycle de l’examen périodique universel, un sondage fut mené auprès de partenaires pour mettre à plat un certain nombre de questions. La première chose fut de connaître auprès des personnes interrogées quelle était la force de l’EPU. La réponse fut que l’EPU
- 1) privilégie une approche d’ensemble (« holistic approach ») eu égard aux obligations des États;
- 2) permet d’établir des liens avec le corpus des droits de l’homme et
- 3) inclut toutes les parties intéressées au processus – ce qui élargit la représentation des personnes et des groupes pouvant bénéficier d’une accréditation.
Autre constat tiré de l’analyse du sondage : l’importance d’assurer un suivi des actions dans le temps et l’obligation de rendre obligatoire tout rapport intérimaire relatif à l’EPU. Fait sans précédent en Asie, semble-t-il, les discussions entourant 2e cycle de l’EPU ont permis à la société civile de discuter avec les autorités d’enjeux qui les concernent au plus haut point, notamment les obligations des États en matière de droits de l’homme. D’autre part, la question se pose quant à savoir comment évaluer le suivi des recommandations formulées dans le cadre de l’EPU? Ce qui soulève la question du choix d’indicateurs par le biais de questions appropriées, par exemple les mesures adoptées pour combattre l’impunité des fonctionnaires de l’État pour leur non-respect des droits de l’homme. À cet égard, des formations adéquates pour palier ces manquements et transgressions eurent lieu grâce à un financement étranger. Mais il reste que le suivi des recommandations demeure un défi constant et que, par conséquent, il convient d’assurer des mises à jour périodiques.
L’égalité de droits homme/femme : Paola Daher
Mme. Paola Daher, Cairo Institute for Human Rights Studies (http://www.cihrs.org/?lang=en).
Fondé en 1993, le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) est une organisation non gouvernementale régionale indépendante qui vise à la promotion et au respect des principes des droits de l’homme dans le monde arabe. Les expériences égyptienne et libanaise en matière d’EPU peuvent se révéler fort utiles et créatrices, notamment en ce qui concerne la place des femmes dans la vie domestique et sociale et leurs droits. En Égypte, dans le cadre de l’EPU, le CHRS a coordonné le travail d’une coalition d’ONG composée entre autres d’organisations de défenses des droits de la femme. La question se posa quant à savoir s’il convenait d’inscrire les droits de la femme dans une catégorie particulière ou dans l’économie générale des droits humains. Il fut convenu que la seconde avenue serait préférable afin d’éviter de perpétuer l’idée selon laquelle les droits de la femme ne sont qu’une catégorie de droits parmi d’autres, ce qui n’empêcha pas pour autant de traiter spécifiquement, par exemple, de la condition des femmes au travail, de leur participation au développement du pays et des structures patriarcales de la société. La mise en œuvre des recommandations en faveur des droits de la femme s’inscrit par ailleurs dans un contexte socio politique en quête de stabilité. Au Liban, il a fallu composer au départ avec un faible niveau de compréhension de l’EPU. La cinquantaine de coalitions a donc choisi au départ d’opter en faveur d’une formation interne pour une mise à niveau de base. Au terme de cet exercice se constitua une coalition nationale riche de sa diversité. Il en a résulté une série de rapports ayant entre autres pour but de susciter un large débat public, ce qui permit semble-il d’inciter davantage les autorités à rendre des comptes. La présence à Genève de représentants de la coalition a permis une meilleure compréhension une plus grande visibilité auprès de diverses instances internationales. De retour au pays, les délégués de la coalition ont poursuivi leur travail de lobbying auprès des autorités et se sont dotés de moyens de communication interactifs (YouTube, Facebook, Twitter,…) de manière à agrandir le cercle des intéressés, notamment en matière de défense des droits de la femme.
Travailler avec la presse et les réseaux sociaux : Jane Larsen
Mme Jane Larsen, International Media Support (IMS) (http://www.i-m-s.dk/), Danemark. IMS fait partie d’un réseau de la presse indépendante présent au sein de 50 pays dans le monde. C’est un levier de la plus haute importance pour vous faire connaître car « si personne ne parle de vous, vous n’existez tout simplement pas ». Les médias figurent au nombre des outils indispensables dans la défense et la promotion des droits de l’homme dont la collecte et l’interprétation de données. Cette approche inclut les applications disponibles sur l’Internet car celles-ci renforcent les connaissances et les capacités d’intervention (Facebook, Twitter, …). Il faut apprendre à se servir des médias à toutes les étapes de l’EPU, y compris lors de la période de suivi. Mais prudence obligeant, il convient de prendre connaissance de ce que les médias ont l’intention d’écrire à votre sujet avant toute diffusion ou mise en ligne. En somme, il faut très bien savoir à qui l’on s’adresse pour sa propre réputation, mais aussi, dans certains cas, pour sa sécurité également.
Travailler avec la presse et les réseaux sociaux : Jane Larsen
Mme Jane Larsen, International Media Support (IMS) (http://www.i-m-s.dk/), Danemark. IMS fait partie d’un réseau de la presse indépendante présent au sein de 50 pays dans le monde. C’est un levier de la plus haute importance pour vous faire connaître car « si personne ne parle de vous, vous n’existez tout simplement pas ». Les médias figurent au nombre des outils indispensables dans la défense et la promotion des droits de l’homme dont la collecte et l’interprétation de données. Cette approche inclut les applications disponibles sur l’Internet car celles-ci renforcent les connaissances et les capacités d’intervention (Facebook, Twitter, …). Il faut apprendre à se servir des médias à toutes les étapes de l’EPU, y compris lors de la période de suivi. Mais prudence obligeant, il convient de prendre connaissance de ce que les médias ont l’intention d’écrire à votre sujet avant toute diffusion ou mise en ligne. En somme, il faut très bien savoir à qui l’on s’adresse pour sa propre réputation, mais aussi, dans certains cas, pour sa sécurité également.
Typologie des bilans en matière de droits fondamentaux
M. Yves Lador, membre du Conseil de direction du CIFEDHOP, consultant et représentant de EarthJustice (http://earthjustice.org/) auprès des Nations Unies, Genève.
La particularité du 2e cycle consiste à faire un bilan global de l’EPU - en tant que « fondement de l’universalité des droits » -, c’est-à-dire un « bilan de santé » des droits fondamentaux en tentant de dégager les tendances dominantes ainsi que les points forts dans chacun des contextes nationaux, ce qui implique la tenue d’un débat national préalable à l’EPU proprement dit. Ce débat a intérêt à 1) s’appuyer sur des faits vérifiables (cadre institutionnel et pratiques - mesures, programmes d’action, indicateurs) et des données objectives ; 2) prendre en compte les perceptions/représentations (sondages, enquêtes de victimation, …). Mais cette approche n’empêche aucunement des approches empiriques (par ex. : par essais et erreurs - qui, compte tenu des contextes, peuvent s’avérer tout aussi efficaces), voire représentatives (par ex. : études de cas par le biais d’ateliers de scénarii sur un sujet portant sur les droits fondamentaux et leurs triples fonctions – protection/prestation/participation). Une fois remplies, cette documentation contribue à placer les échanges entre les différents secteurs du monde associatif dans le cadre d’un regroupement d’une information de base partagée d’un commun accord.
Cela étant, il convient d’opter pour la meilleure stratégie possible en choisissant des thématiques porteuses (droits de la femme, de l’enfant, etc.) et des procédures juridiques appropriées. Pour la meilleure efficience possible de cette entreprise, il importe que celle-ci soit l’expression d’une « cohérence interne » par laquelle les diverses composantes de la société civile se seront exprimées d’une même voix à partir d’une bonne connaissance du terrain (diverses coalitions thématiques s’unissant autour de cibles communes, pour un discours unifié). La recherche d’appuis revêt également un caractère important (universités, médias, entreprises privées – par exemple, là où existent des politiques internes de non discrimination hommes/femmes, minorités ethniques/majorité, …). Dans un second temps, il conviendra de porter à l’attention de la tribune internationale les résultats de l’exercice et par là, possiblement, atteindre la grand public. Une fois l’EPU passé, la mobilisation doit se poursuivre, car les suites à donner revêtent une toute aussi grande importance (en aval) que la stratégie d’origine (en amont). Comme le processus de l’EPU est récent, il faudra sans doute attendre les 3e, 4e ou 5e cycles, le cas échéant, pour disposer d’une masse critique des données et d’expériences permettant de prendre la mesure de l’impact de la société civile sur les politiques étatiques en faveur des droits et libertés de la personne (respect, protection et mise en œuvre). Tout s’inscrit donc dans la durée.